Histoire vécue au cabinet dentaire
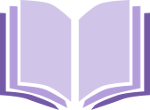
Je voudrais vous conter trois petites histoires que j’ai vécues dans l’exercice de ma profession.
Elles ne vous apporteront probablement rien sur le plan de la connaissance des problèmes médicaux de la sphère oro-faciale. Mais comme leur décor est un cabinet dentaire, vous les rapporter ne m’apparaît pas totalement hors sujet.
A cette époque, frais émoulu de l’Université et disposant d’un capital plutôt léger, je choisis de m’installer dans un quartier populaire de Paris, plus exactement Place de Ménilmontant, dans un appartement de plain-pied, qui donnait l’impression en franchissant son seuil d’être encore dans la rue, tant y résonnaient les clameurs et le tintamarre ambiants. Ce n’est un secret pour personne que la population de ce quartier est très bigarrée et que des flux de migrants s’y chassent ou s’y croisent dans la plus pure tradition d’hospitalité française. Bref, une vraie tour de Babel ou de Bab-El-Oued.
Comme j’ai aimé partager, en ma qualité de chirurgien-dentiste, dans les années 90, les années Goldman, le quotidien de cette foule vibrante, chaleureuse, attachante, sincère, simple, d’une dignité surprenante et chatouilleuse, et préoccupée par un problème étranger à la plupart d’entre nous: la survie.
Mon cabinet dentaire recevait outre une population indigène, à peu près semblable à celle de tout l'hexagone, des patients venus des quatre coins de la Terre, que dis-je de l’Univers.
Un sort contraire avait affligé ces derniers d’une rage de dent ou d’un abcès voire d’un phlegmon, dont il fallait se débarrasser au plus vite pour pouvoir,sans délai, poursuivre leur quête obsessionnelle: la survie. Si j’osais une comparaison, je déclarerais que mon cabinet tenait donc davantage de la station-service où l’on trouve à remplacer un pneu crevé par un rechapé que du palais de la mécanique où l’on règle la teneur en CO des gaz d’échappement.
Par un après-midi d’été caniculaire, pénètre dans ma station-service, un superbe Africain, comme aurait aimé le décrire Agatha Christie, sculpté dans l’ébène, dont les bras évoquent immanquablement des essieux, habillé sans excès de distinction d’un pantalon rose fuchsia et d’une chemise jaune cocu. A peine plus étroit que le corridor où il progresse, il m’envoie un “ Bonjourrr Doctère” des plus tonitruants et s’engouffre, sans ma permission, dans la salle de soins, l’éventualité de patienter dans la salle d’attente lui étant bien évidemment étrangère.
Par chance, le fauteuil était vide. Voilà notre Iago qui s’y installe confortablement .
Je me rapproche de lui. Il me montre une deuxième molaire inférieure gauche, qui dans une association d’idée irrépressible me renvoie au métro de mon enfance et à ses tickets poinçonnés. Une carie énorme a déterminé un véritable cratère dans la malheureuse dent.
“ Doctère, j’ai trrès mal. J’ai pas dorrmi dés nuits” me dit-il en brandissant son index et son majeur, non pour signer le “v” de la victoire, mais pour joindre le geste au mot, comme si j’ignorais que “dés” signifiait “deux”.
- On peut essayer de soigner la dent, Monsieur, si vous voulez. Il faut la dévitaliser et à la prochaine séance…
- Tire !
Je traduis pour vous: “Tire” veut dire “Extrais”.
- C’est dommage…
- Tire, jé té dis, avec un soupçon d’impatience dans la voix.
Je sais que toute l’éloquence du monde ne parviendra pas à ébranler sa détermination de se séparer de sa dent, comme il l’aurait fait d’une femme infidèle. Aussi, je me résous à extraire la molaire.
- Je vais vous prendre une radio, une photo de la dent.
- Pas bésoin de photo .
- Pour extraire la dent, c’est…
- Enlève, j’ai dit !
Cette fois-ci, l’impatience a des relents de menace. D’un naturel très conciliant, du haut de mon mètre soixante-cinq, j’acquiesce de la tête pour lever toute ambiguïté sur mes intentions et lui signifier que je vais m’exécuter. Je garnis donc ma seringue pour procéder à l’anesthésie.
-Ouvrez la bouche, s’il vous plaît.
D’un geste mécanique que j’avais déjà répété des milliers de fois, je dirige l’aiguille au-dessus de la troisième molaire pour injecter le produit insensibilisant. A mon grand étonnement, l’aiguille comme mue par un invisible ressort semble rebondir contre la muqueuse. Interpellé par l’étrange phénomène, je vérifie que j’ai bien armé ma seringue. Rassuré, je réitère mon geste. Là, la pointe de l’aiguille se tord, à ma stupéfaction.
Devant mon désappointement, le visage de mon patient africain s’épanouit dans un sourire aussi éblouissant qu’un soleil sur la brousse. D’un air triomphant, il m’explique;
-Attends ! Laisse-moi enlever mon grigri. Avec le grigri, ti né pé pas me trransperrcer !
Il se lève, déboutonne sa chemise, dénoue une espèce de lanière de cuir bizarrement tressée qu’il ôte et soupèse respectueusement dans sa paume. Avec un agile mouvement des doigts, il reboutonne sa chemise et se rajuste avant de se rasseoir.
Très surpris par le tour des événements, je change l’aiguille au bout de ma seringue et procède à une troisième tentative d’anesthésie. Cette fois-ci, l’aiguille biseautée glisse sans encombre et je peux enfin injecter le produit.
L’extraction se déroule parfaitement. Quand je lui demande 144 francs pour mes honoraires, mon patient m’abandonne un Montesquieu ( 200 francs) et ajoute:
“Pour toi. Ti m’a bien aidé”.
Bien sûr, dix-huit ans passés sur les bancs de l’école républicaine et laïque m’ont appris que les amulettes, grigris et talismans de tous ordres n’étaient d’aucune utilité. Je sais combien l’auto-suggestion peut agir sur notre inconscient, nos actes et la tonicité de nos tissus. Mais j’avoue que je n’aimerais pas affronter mon bel Africain, paré de son grigri, en combat singulier à l’arme blanche.
S.D.




